Je l’espérais, ils l’ont fait. Au moment où Matthieu Gallet espère que la Caisse des dépôts et consignations offrira le gîte et le couvert à l’Orchestre National de France, la Maison Ronde ouvre la malle aux trésors de l’INA pour en garnir généreusement huit galettes.
J’applaudis, d’autant que le National aura traversé quatre-vingt ans de vie musicale parisienne avec une appétence pour le répertoire français et une dévotion à la création qui en firent un modèle dans une ville où les associations symphoniques ronronnaient calmement le grand répertoire de matinée en soirée.
Cette vertu de la découverte est bien illustrée ici. Sommet de l’album, la Première Symphonie d’Henri Dutilleux captée à sa création et dans son tout premier état – Dutilleux repeignera l’œuvre, écourtera le Finale en supprimant un fugato pas si redondant que cela – le 7 juin 1951. Roger Désormière dirige, baguette exacte, main gauche poète, cela ondoie et claque, le rêve délité de l’Intermezzo vous porte loin, une sorte de perfection qui me pousse à constater une fois de plus que la poétique de Dutilleux tombe exactement dans le timbres des instruments d’alors, leur creusement, leurs alliages un peu verts, tout ce qui manque à l’enregistrement récent de Paavo Järvi et de l’Orchestre de Paris : Dutilleux n’aime pas le confort moderne.
 D’ailleurs c’est tout le disque consacré aux créations qui remporte la palme, même si on eut aimé y retrouver le scandale de la première audition de Déserts, bien que l’INA l’ait déjà éditée par ailleurs. La Dame de Monte-Carlo menée à son suicide avec un brio déchirant par Denise Duval est anthologique ; Lukas Foss transforme ST/48 de Xenakis en incantation simplement faramineuse, et Cathy Berberian est étreignante dans Calmo sous la direction de Berio, document d’importance car à ma connaissance elle ne l’a pas enregistré au disque. Seule ombre, les Sept Haikaï de Messiaen ânonné par l’orchestre malgré Seiji Ozawa également desservi ici par une version oubliable de La Mer de Debussy, un auteur dont il ne grava officiellement que La Damoiselle élue…
D’ailleurs c’est tout le disque consacré aux créations qui remporte la palme, même si on eut aimé y retrouver le scandale de la première audition de Déserts, bien que l’INA l’ait déjà éditée par ailleurs. La Dame de Monte-Carlo menée à son suicide avec un brio déchirant par Denise Duval est anthologique ; Lukas Foss transforme ST/48 de Xenakis en incantation simplement faramineuse, et Cathy Berberian est étreignante dans Calmo sous la direction de Berio, document d’importance car à ma connaissance elle ne l’a pas enregistré au disque. Seule ombre, les Sept Haikaï de Messiaen ânonné par l’orchestre malgré Seiji Ozawa également desservi ici par une version oubliable de La Mer de Debussy, un auteur dont il ne grava officiellement que La Damoiselle élue…
Bravo aux sélections historiques, Ingelbrecht (Nocturnes, 20 mars 1958 pour les célébrations du 40e anniversaire de la mort de Debussy), Paray (Ouverture du Roi d’Ys), Munch (encore la Deuxième Suite de Bacchus, hélas pas le meilleur soir), Rosenthal dans le rare Hymne à la justice de Magnard (mais j’eusse préféré des Ravel voir Le Bateau ivre de Delage quitte à publier de l’inconnu), Pierre Bernac, de style et de ton impayables dans les Chansons villageoises de Poulenc, la Suite de L’Oiseau de feu selon Cluytens, brillante et mystérieuse à la fois, sont de beaux ajouts aux discographies des chefs.
Autre sommet, la création française des Altenberg-Lieder d’Alban Berg par Irma Kolassi, somptueuse et ardente comme toujours, malgré un orchestre qu’Horenstein peine à mettre au point : simplement cette langue n’était pas encore assimilée en France en 1953. Formidable Till selon Krips, élégant et ironique, Los Angeles divine pour les deux Chants hébraïques de Ravel, c’est Paul Kletzki qui lui soigne ses accompagnements, et deux beaux témoignages de Carl Schuricht, l’Ouverture de Coriolan, impérieuse et un sublime cycle du Fahrenden Gesellen avec le jeune Fischer-Dieskau, un modèle.
Après les choses se gâtent parfois. Tout net : les albums concertants sont inutiles, sinon pour le Tchaikovski selon Ferras et Jochum, chanté fièrement par le premier, emporté avec lyrisme par le second. Mais Isaac Stern est souvent bien lourd dans le Brahms qu’on écoutera plutôt pour la direction sostenuto d’Eugene Ormandy, et Argerich avec Abbado ne nous apprennent rien de plus sur leur Troisième de Prokofiev, idem pour Yo-Yo Ma dans le Dvorák.
Bernstein tire son épingle du jeu, épatant dans l’Ouverture de Raymond ou Le Secret de la reine d’Ambroise Thomas, subtil et brûlant pour la Shéhérazade de Marylin Horne. Et Muti délivre une 93e de Haydn parfaitement modelée, élancée, impeccable, mais tout ce qu’il a engrangé avec le National devrait faire de toute façon l’objet d’une édition exhaustive !
On aurait préféré pour Celibidache des Ravel (Daphnis), plutôt que les Prokofiev sélectionnés. Cinglante Première de Chostakovitch selon Kurt Masur, un Dutoit et deux Gatti sont éclipsés par Le Sacre du Printemps avec lequel Lorin Maazel souleva le Théâtre des Champs-Elysées le 8 juillet 1980, j’y étais, j’en frémis encore.
Au moment de refermer l’album, une colère me prend. Rien de Jean Martinon, le directeur de l’Orchestre de 1968 à 1974, brièvement évoqué dans le texte de Christian Wasselin, illustré par une belle photographie. Mais pas de son.
Même si la collaboration du National et de Martinon a été abondamment illustrée au disque, constituant une précieuse anthologie de la Musique Française, cette absence, après le refus de la Mairie de Paris d’apposer une plaque mémorielle à son domicile du XVIIIe arrondissement, résonne comme une seconde discrimination, car il ne peut s’agir d’un oubli et on ne saurait prétexter de la nécessité de choisir pour écarter cette figure centrale dans la vie et l’évolution artistique de l’Orchestre National !
Dommage, car l’album est superbe, agrémenté d’un livret abondamment illustré, et les remasterings qu’il propose sont en tous points somptueux.
LE DISQUE DU JOUR
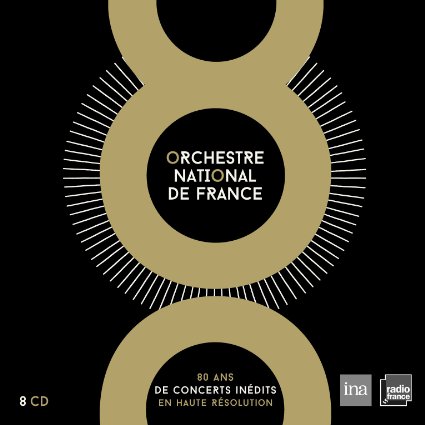
Un coffret de 8 CD du label INA Radio France FRF 020-27
Photo à la une : (c) DR
